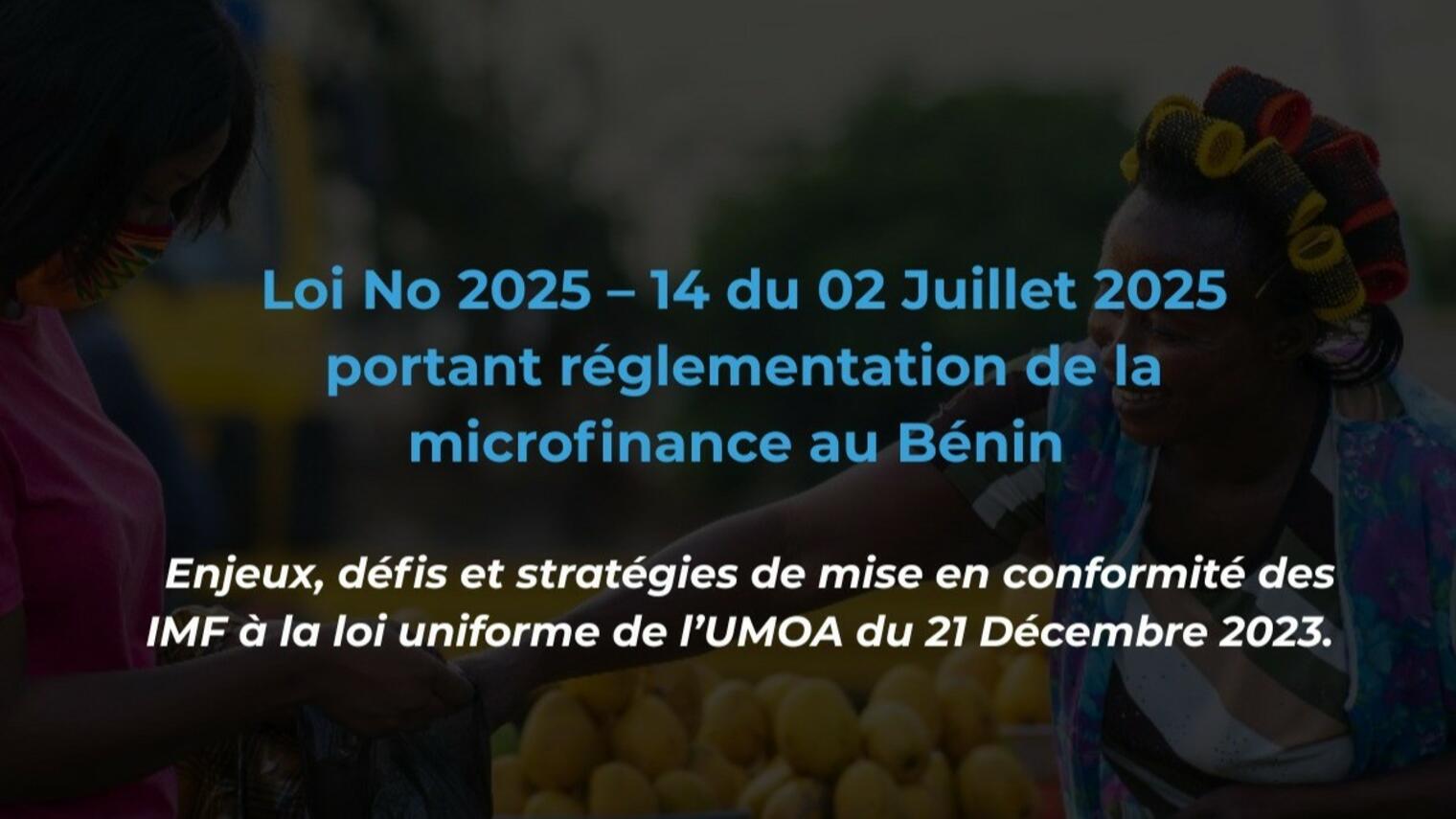Un tournant décisif dans la régulation de la microfinance en Afrique de l’Ouest
L’adoption, le 21 décembre 2023 à Cotonou, par le Conseil des Ministres de l’UMOA, de la nouvelle loi uniforme portant réglementation de la microfinance marque un tournant décisif dans l’histoire du secteur financier décentralisé de l’Union. Cette réforme ambitieuse, structurée en (10) dix titres et (173) cent soixante-treize articles, consacre un cadre juridique et prudentiel renforcé destiné à corriger les déséquilibres structurels observés dans le secteur, à moderniser les outils de supervision et à garantir la protection effective des usagers. Chaque État membre, conformément aux prescriptions communautaires, disposait d’un délai de six mois pour intégrer cette législation dans son ordre juridique national. Le Bénin, bien qu’ayant accusé du retard, a délibéré et a adopté cette loi par l’assemblée nationale en sa séance du 25 Juin 2025 et promulgué par le Président de la république par décret pris en conseil des ministres le 02 Juillet 2025.
De la genèse à l’essor d’un secteur en pleine mutation
Historiquement, la microfinance ouest-africaine s’est constituée comme une réponse alternative à l’exclusion bancaire. Dès les années 1990, la loi PARMEC a structuré un secteur en pleine effervescence, en instaurant les premières règles de reconnaissance juridique, d’octroi d’agrément et de supervision prudentielle. Toutefois, l’accroissement rapide du nombre d’acteurs, les limites de gouvernance observées, la montée en puissance de l’innovation technologique et l’évolution des risques ont rapidement rendu ce cadre obsolète. Le Bénin s’inscrit dans la dynamique communautaire en transposant, à travers la loi n°2012-14 du 21 mars 2012 dans les dispositions législatives nationales la loi portant réglementation des SFD dans l’UMOA adopté le 07 Avril 2007. Cette loi, bien qu’ayant permis une professionnalisation partielle du secteur, a montré ses limites face à la complexité croissante des pratiques et à la fragilité de certaines catégories d’institutions
Une croissance déséquilibrée du secteur de la microfinance béninois
Entre 2012 et 2024, le secteur béninois de la microfinance a connu une expansion quantitative significative, tant au niveau des dépôts collectés que du nombre de clients servis ainsi qu’en termes d’acteurs opérant dans/avec le secteur. Selon les chiffres de l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (ANSSFD), en 2024 on y dénombre (107) cent sept institutions formelles, dont (83) quatre-vingt-trois IMCEC (Institutions Mutuelles et Coopératives d’Epargne et de Crédit) représentant plus de 77 % du marché, (13) treize associations, et (11) onze sociétés de capitaux. Le nombre de clients a plus que triplé, atteignant près de 4,9 millions, tandis que les encours de crédits sont passés de 36,7 à 204,8 milliards FCFA. Toutefois, cette croissance s’est accompagnée de déséquilibres persistants : gouvernance défaillante, sous-capitalisation chronique, détérioration continue des portefeuilles, faible interopérabilité des systèmes d’information de gestion, absence de dispositifs efficients de contrôle interne, et forte concentration géographique. La montée en puissance d’acteurs informels et de plateformes frauduleuses a également fragilisé la réputation du secteur, justifiant une réforme d’envergure.
Une architecture juridique rénovée et ciblée
La nouvelle loi introduit une refonte structurelle du cadre normatif en recentrant la réglementation sur l’activité elle-même, et non uniquement sur les formes juridiques. Elle limite l’exercice légal de la microfinance aux institutions constituées en Société Anonyme à capital fixe ou en Société coopérative à capital variable, excluant de facto les associations et les SARL. Elle impose un capital social minimum, renforçant la solvabilité des IMF, et généralise l’obligation de disposer d’un SIG conforme, interopérable avec la plateforme régionale. Elle formalise la finance islamique comme modalité autorisée d’intervention et encadre rigoureusement les opérations accessoires. En matière de gouvernance, elle rend obligatoire la création de comités spécialisés, définit des conditions de moralité et de compétence pour les administrateurs, interdit certains cumuls de fonctions, et établit des exigences précises en matière de contrôle interne. Elle introduit également des obligations nouvelles en matière de protection des clients, de traitement des réclamations, de transparence tarifaire et de conformité aux standards de protection des données personnelles.
Les IMF béninoises face aux exigences réglementaires
Le diagnostic de conformité mené en 2024 par Mr Aboubakari ABOUDOU, Expert en Microfinance et Management des organisations, Consultant sur « État de préparation des IMF face aux exigences de la nouvelle réglementation » pour le compte de l’ANSSFD révèle une préparation insuffisante des IMF béninoises. Une proportion significative d’institutions ignore encore le contenu de la nouvelle loi et ses implications. Seules 41 % d’entre elles déclarent envisager une transformation institutionnelle. Parmi les IMCEC non affiliées, certaines refusent l’idée d’affiliation, tandis qu’aucune des faitières existantes n’envisage de les intégrer. Les associations, pour leur part, ne répondent plus aux critères juridiques autorisés, et leur transformation en SA requiert un processus complexe de structuration du capital et de réingénierie organisationnelle. La majorité des IMCEC, y compris celles qui souhaitent poursuivre en tant que coopératives, disposent d’un capital social largement inférieur au seuil informel, et seront donc contraintes de s’affilier ou de se recapitaliser. Le délai de douze mois impartis pour se conformer apparaît, pour la majorité des acteurs, comme irréaliste au regard des démarches à accomplir.
Des implications structurelles majeures pour les IMF
Les implications concrètes de cette réforme sont multiples. Sur le plan juridique, elle impose une requalification immédiate du statut des institutions non conformes. Sur le plan prudentiel, elle conditionne la poursuite de l’activité à une capitalisation adéquate. Sur le plan organisationnel, elle requiert la mise en place de dispositifs de gouvernance renforcés, de SIG normés et de procédures internes alignées avec les standards régionaux. Certaines IMF seront contraintes de se regrouper, de fusionner ou de se retirer volontairement du marché. Pour d’autres, notamment celles classées en zone de vulnérabilité systémique, seule une recapitalisation soutenue permettra d’éviter une liquidation ordonnée. Sans accompagnement ciblé, une part importante du secteur pourrait ainsi basculer dans l’informel ou disparaître, avec des effets délétères sur la couverture des besoins financiers des populations à faible revenu limitant leurs possibilités d’être inclus financièrement et de mettre en place des initiatives économiques pouvant les extraits de la pauvreté.
Face à ces enjeux, il devient impératif de déployer une stratégie d’accompagnement multidimensionnelle. Selon les recommandations de cette étude diagnostic, À court terme, il s’agit d’organiser des sessions de sensibilisation ciblées, par typologie institutionnelle, afin de vulgariser les obligations légales. À moyen terme, la mise à disposition d’outils pratiques, guides de transformation statutaire, statuts types, référentiels de gouvernance, cahiers des charges SIG, sera indispensable. À long terme, l’écosystème national devra intégrer des mécanismes d’incitation et de soutien à la restructuration, tels qu’un fonds de recapitalisation, des plateformes de SIG mutualisées ou encore un répertoire de dirigeants certifiés.
Les défis numériques : entre opportunités technologiques et impératifs de transformation digitale
La mise en conformité des IMF passe aussi par une transformation digitale profonde, désormais incontournable. La nouvelle loi impose l’intégration de systèmes d’information de gestion (SIG) conformes, interopérables et sécurisés, ce qui constitue un défi technique majeur pour de nombreuses institutions encore faiblement équipées.
Au cœur de cette transformation, la gestion efficace des données devient centrale. Elle conditionne la qualité du reporting, la transparence vis-à-vis du régulateur et la protection des clients. La montée des obligations en matière de protection des données personnelles impose la mise en place de dispositifs de sécurisation robustes et conformes à la loi Loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin en son livre 5 consacré à la protection des données à caractère personnel.
Par ailleurs, l’usage de l’intelligence artificielle dans la microfinance notamment pour l’évaluation des risques, la détection de fraudes ou l’optimisation des offres ouvre de nouvelles perspectives d'efficacité. Mais ces opportunités restent limitées par le faible niveau de maturité numérique des IMF, le manque de données structurées et l’absence d’un encadrement spécifique. Répondre à ces défis implique un accompagnement ciblé, une montée en compétences et l’adoption progressive de solutions technologiques adaptées aux réalités du secteur.
Inclusive Finance Accelerators : un partenaire stratégique pour une conformité réussie
Dans cette perspective, Inclusive Finance Accelerators (IFA) se positionne comme un acteur central du processus d’accompagnement à la mise en conformité. Fort d’un réseau de consultants seniors spécialisés en microfinance, en ingénierie institutionnelle, en gouvernance et en conformité réglementaire, IFA propose une expertise intégrée, ancrée dans les réalités du terrain. Son pool d’experts, cumulant plus de vingt années d’expérience, intervient tant auprès des IMF qu’auprès des autorités nationales et des partenaires techniques. IFA offre des services complets : diagnostic de conformité, appui à la transformation juridique, refonte des outils de gouvernance, déploiement de SIG certifiés, formation des organes de contrôle, mise en place des dispositifs clients, appui au reporting réglementaire et à la conformité sociale. L’approche méthodologique d’IFA repose sur la co-construction de solutions viables, l’appropriation par les institutions bénéficiaires, et le renforcement durable des capacités.
La réforme engagée par l’UMOA constitue une avancée normative majeure et une opportunité de refondation pour le secteur. Pour les IMF béninoises, elle appelle à une profonde réorganisation institutionnelle. Le succès de cette transition dépendra de la qualité de l’accompagnement technique, de la coordination des acteurs de l’écosystème et de la capacité des institutions à se réinventer dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Dans ce cadre, IFA se présente comme un partenaire stratégique crédible, structuré et mobilisé au service d’une microfinance plus professionnelle, plus résiliente et pleinement alignée sur les exigences du cadre communautaire.
Médéric R. K. HOUNGBO Conseiller Technique Finance Inclusive - IFA